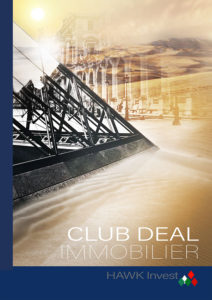C’était en 1983, j’avais 11 ans, encore l’âge de l’insouciance, des rêves et de la naïveté. Je n’ai pas le souvenir d’avoir connu de grands drames avant cette année-là si ce n’est la victoire de François Mitterrand en mai 1981 mais c’était davantage un drame par procuration. Je me rappelle ce dimanche 10 mai à 20 heures quand le visage du nouveau président de la République est apparu sur l’écran de la télévision Continental Edisson du salon du rez-de-chaussée. J’aimais beaucoup ce téléviseur blanc avec son pied tulipe, il appartenait pour moi au futur avec sa forme ovoïde.
Maman m’a demandé d’aller prendre ma douche mais j’insistais pour voir la tête de celui que ma famille haïssait parce que de gauche et surtout parce que alliée des communistes ceux-là même qui avaient voulu éliminer Bon-Papa à la fin de la guerre parce que son joli petit manoir n’avait pas été réquisitionné par les Allemands. De là en faire un collabo, ce n’était ni plus ni moins que la traduction des procès staliniens.
Donc en 1983, j’étais en sixième pour la 2ème fois. Je n’aimais pas l’école et encore moins le pensionnat dans cette austère maison du début du XXème siècle que nous appelions Cendrillon. Il y avait d’immenses pièces rectangulaires, l’une pour le réfectoire, l’autre pour l’étude, d’autres pour les dortoirs ou les douches. Tout me semblait sans âme, si ce n’est la chapelle et le bureau du Père Supérieur avec son salon Napoléon III vert Irlandais. Sur le palier en haut de l’escalier, entre les deux grandes doubles portes de son bureau, il y avait le portrait de Monseigneur Paul Lahargou, fondateur du collège. Cette peinture me faisait peur, quand je passais devant j’avais l’impression que le Père Lahargou me suivait du regard comme s’il avait un œil sur moi !
L’ambiance était studieuse, on entendait les mouches voler en étude mais aussi les baffes. Il valait mieux se tenir à carreaux pour ne pas prendre une « tougne », spécialité de la maison. Il fallait mettre les bras croisés dans le dos, se tenir droit devant le surveillant et lui indiquer la main de notre choix, droite ou gauche. Les petits nouveaux qui, ayant observé si le surveillant écrivait de la main droite ou gauche, choisissaient la moins agile ne savaient pas que pour la « tougne », il était ambidextre.
Nos journées étaient rythmées par la prière et les cours. C’était plutôt l’ambiance des Choristes que celle des Surdoués passent le bac. Aujourd’hui, j’ai une forme de nostalgie pour cette période, j’y ai découvert ce qui fait de moi un homme.
Au dortoir, nous avions des lits superposés ; je ne me souviens pas combien nous étions mais il devait y avoir une bonne soixantaine de gamins avec au fond de la pièce dix lavabos et deux chiottes. L’eau était froide si bien que l’année suivante quand il a fait très froid nous avons été renvoyés dans nos familles car l’eau avait gelé dans les canalisations. Mon lit était à côté d’une haute fenêtre avec ses volets intérieurs qui donnait sur la cour de récréation au milieu de laquelle se dressait la chapelle. Derrière chaque lit il y avait une armoire avec deux portes, à droite pour celui du haut et à gauche pour l’interne qui dormait en bas.
En face de moi, près d’une porte qui conduisait au couloir des grands, il y avait le lit de Ludovic. Il avait comme patronyme celui de l’astre de la divinité. Il était pourtant malingre, d’une blancheur marmoréenne, les yeux bleus et les cheveux blonds. Discret, taiseux, il n’était pas à l’aise. Nous étions des enfants mais nous étions seuls, sans nos parents, sans nos doudous. Je n’ai d’ailleurs pas le souvenir d’en avoir déjà eu. Ludovic habitait Ychoux, une commune le long de la ligne SNCF où le TGV ne s’arrête jamais sauf quand il y a une panne avant Dax. Enfant, je trouvais ce nom très laid et la commune encore plus. Il n’y avait rien si ce n’est une gare qui regarde passer les trains. Il n’y a pas l’océan, pas de ville, il n’y a que le souvenir des forges qui ont fait la fierté du village. Je plaignais Ludovic d’habiter là-bas, moi qui regardais son village depuis le compartiment de mon wagon à bord de la Palombe Bleue que nous empruntions avec ma grand-mère pour rejoindre Paris depuis Dax. Nous n’étions pas amis, seulement camarades de dortoir.
Un soir Ludovic a trouvé une enveloppe dans son armoire. Une enveloppe en papier Vergé Bis. Je ne sais pas ce qui était écrit mais c’était méchant, vil, gratuit. Ludovic est allé trouver le surveillant, M. Navarre, un grand gaillard avec une banane sur la tête. Il devait être fan des Forbans.
Très vite, je suis désigné comme l’auteur de la missive. Je me retrouve en face de Navarre, les bras croisés derrière le dos et sans réfléchir, je dis la gauche. Ma tête vole au-dessus de mon cou, les larmes coulent sur mes joues. Je n’ai personne vers qui me tourner. Je remonte dans mon lit en sanglot avec la rage de l’injustice.
Le lendemain, isolé, je suis celui qui a harcelé un camarade. Celui qui a humilié un autre enfant pour sa différence. A l’heure du déjeuner, je prends mon courage à deux mains et en sortant du réfectoire, je conteste devant le Père Supérieur, le Chanoine Jean Bernadet, les faits. Je reverrai toujours cet homme d’une bonne cinquantaine d’années avec son accent du Sud-Ouest, ses oreilles décollées, son col cheminée noir et son costume gris planté devant moi me disant que je mérite une bonne correction.
Il m’impressionnait plus par respect que par crainte. Sans me démonter avec une totale inconscience je lui dis que pour savoir si je suis l’auteur il faut faire une analyse graphologique. C’est ce qui me sauvera d’une raclée dont les tenants de l’autorité du collège avaient le secret et sans doute aussi d’une exclusion.
Je ne me souviens pas qui avait pu écrire cette lettre anonyme mais je sais que c’est la première injustice que j’ai vécue.
Je n’ai jamais revu Ludovic Soleil, il est décédé en 2018, il avait 46 ans.